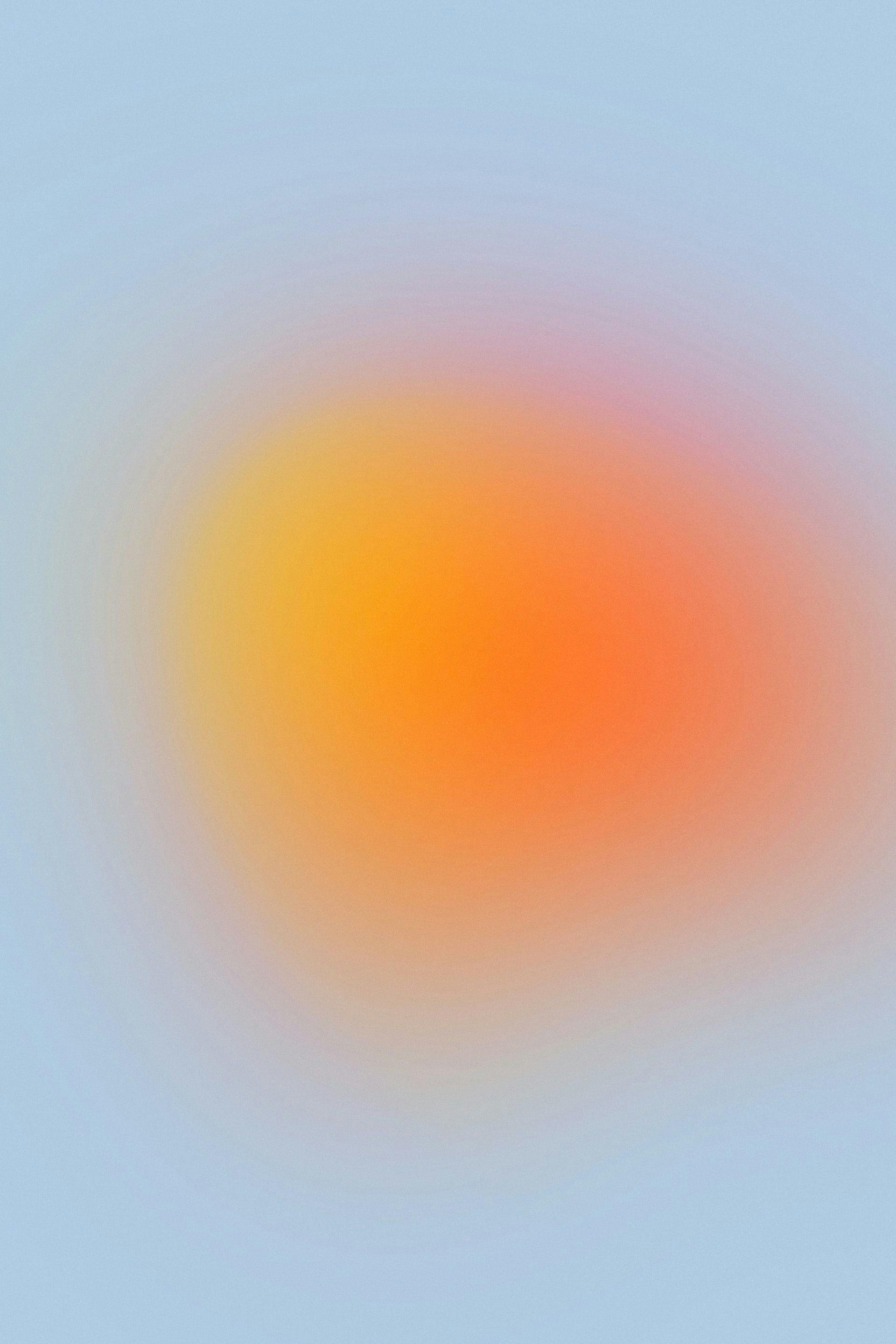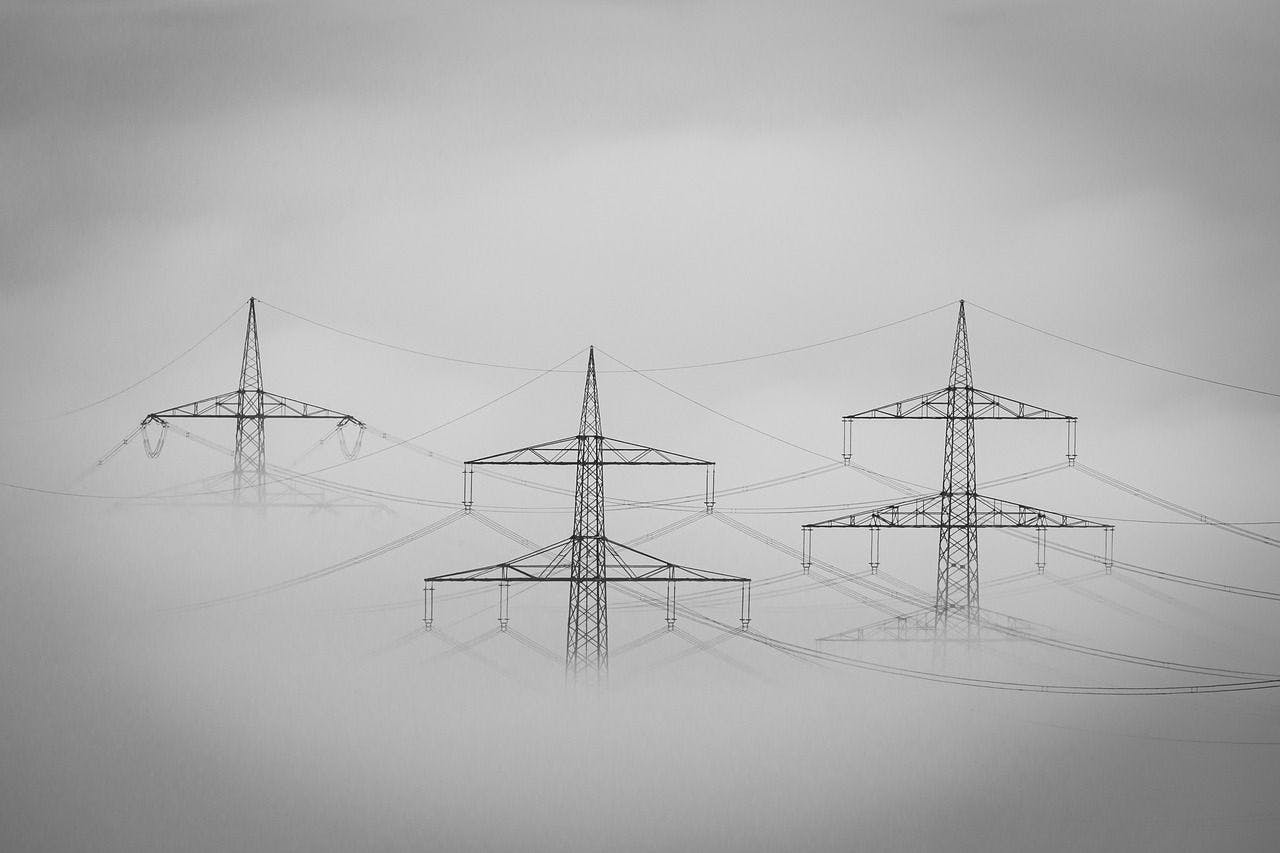Programmation énergétique : après l’obscurité à l’Assemblée, on rallume la lumière ?
PPE : rappel des faits
Contexte
Dans la confusion d’un hémicycle de l'Assemblée nationale presque vide, la proposition de loi dite “PPL Grémillet” s’est vue très largement amendée puis finalement rejetée fin juin 2025, pour ensuite reprendre son chemin au Sénat début juillet. En marge du Conseil européen du 26 juin, le président Macron a semblé conditionner l’adhésion de la France aux objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2040 (-90% par rapport à 1990) à un traitement plus équilibré du nucléaire par rapport aux énergies renouvelables. Dans le même temps, la publication du rapport sur les causes du black out espagnol ne fera pas changer d’avis les commentateurs déjà convaincus : à leurs yeux, les énergies renouvelables seraient responsables, coûteuses, inutiles et dangereuses pour le réseau.
L’actualité énergétique est riche, mais les concepts et enjeux semblent parfois troubles et non hiérarchisés pour certains protagonistes. La politique énergétique ne peut s’appuyer sur une conception idéologique. Rappelons quelques faits, en nous concentrant sur la période 2025-2035.
La France est actuellement en “surproduction” d’électricité et c’est plutôt une bonne nouvelle
Depuis 1980, cela a quasiment toujours été le cas. Entre 2010 et 2021, la France a eu un solde exportateur net en moyenne de 55 TWh d’électricité par an. 2022 a été une année singulière en raison de la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, d’un déficit de production hydroélectrique, de problèmes de corrosion sous contrainte sur une dizaine de réacteurs nucléaires ainsi qu’un calendrier plus largement chargé de maintenance du parc nucléaire hérité des arbitrages lors de la pandémie de Covid-19. Résultat : la France est devenue importatrice nette (-17 TWh). Une année noire, mais retour à la normale dès 2023 avec 50 TWh de solde exportateur net et même un record historique en 2024 avec environ 90 TWh[1].
Cette “surproduction” (plus d’exports que d’imports) est une bonne nouvelle pour la France et l’Europe :
- elle contribue à réduire les prix qui ont retrouvé en 2024 des niveaux proches de l’historique d’avant-crise, confirmant la baisse initiée en 2023[2] ;
- elle génère un excédent commercial pour la France : 4 milliards d’euros en 2024[3] ;
- notre électricité étant bas-carbone, les exportations permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre en évitant que nos voisins fassent fonctionner leurs centrales à énergies fossiles[4].
Même si l’électricité est un bien particulier, quand la France exporte des voitures ou du vin, la “surproduction” n’est pas vue négativement.
2024 marque, certes, un record, mais il faut penser à long terme. Toutes les années ne se ressemblent pas. Qui peut prédire quel sera l’impact de la prochaine crise climato-géopolitique ? Mieux vaut en avoir sous le pied que le contraire.
Pour aller plus en détail, cette “surproduction” se caractérise également par des heures de la journée où la production excède la demande. Typiquement, quand les panneaux photovoltaïques produisent massivement en France comme chez nos voisins, les prix sur le marché SPOT (qui n’influent qu’en partie sur les prix des contrats de fourniture) deviennent négatifs. Cette tendance s’accélère : sur le premier semestre 2025, il y a eu 32% d’heures à prix négatifs de plus que sur la même période en 2024[5]. Au mois de mai, 90% des jours ont connu des prix négatifs ou nuls, avec un prix moyen sur le mois de 19 €/MWh[6].
Est-ce pour autant un problème ? Cela signifie qu’il nous faut apprendre à gérer cette énergie abondante très peu chère. De nombreuses solutions existent pour mieux en tirer profit, tout en conservant des modèles économiques pour les producteurs : augmenter le nombre d’heures creuses en journée pour encourager la flexibilité et le pilotage des consommations[7], modifier les contrats types pour les installations soutenues par l’Etat[8], augmenter certaines consommations (production d’hydrogène, recharge de batteries), etc.
Enfin, ces prix négatifs poussent les centrales nucléaires à “moduler” (réduire leur puissance), pour laisser la place aux renouvelables, faute de débouché économique. Aujourd’hui de l’ordre de 1-2 TWh, RTE prévoit une augmentation de ces périodes “subies” par le parc nucléaire d’ici 2035, de l’ordre de 15 TWh (< 4% de la production nucléaire)[9]. Reposant principalement sur des coûts fixes (amortissement construction, salaires), cela induit une perte financière non négligeable pour l’industrie nucléaire. Il serait logique de réfléchir à un dispositif pour équilibrer la cohabitation de l’ensemble des filières bas-carbone, à l’image des contrats de complément de rémunération du solaire qui incitent à ne pas produire dans certaines conditions.
Accroître l’électrification permettrait non seulement d’atténuer cette surproduction, mais également d’alléger la facture d’énergies fossiles, de créer des emplois et de rendre la France plus indépendante sur la scène internationale
60% de l’énergie consommée en France est d’origine fossile. Au-delà des enjeux climatiques, s’en affranchir réduit notre facture énergétique, crée des emplois localement et renforce notre souveraineté. Pour cela, électrifier nos usages est fondamental : d’environ 25% aujourd’hui à plus de 50% d’ici 2050[10]. Or ce taux d’électrification stagne en Europe, contrairement à d’autres pays comme la Chine[11].
Pour la France, entre 2010 et 2023, ce taux est resté stable autour de 26-27%. Il est donc urgent de changer de dynamique[13].
Du côté de la production d’électricité renouvelable, il est à noter que les rythmes de développement de l’éolien terrestre et en mer sont conséquents, mais en deçà des objectifs que le pays s’était donnés[14].
Entre les objectifs et la pratique, les rythmes de déploiement des filières peuvent évidemment être recalibrés, mais de façon équilibrée car les “stop and go” sont délétères pour n’importe quelle filière industrielle, renouvelable ou nucléaire, qui a besoin d’un cadre de développement stable.
Ainsi, ne nous trompons pas de débat, ce sont bien les moyens pour accélérer l’électrification des usages qu’il nous faut trouver, et non éternellement s’attarder sur la production.
Oui, la consommation d’électricité en France devrait augmenter d’ici 2035
Prédire la consommation d’électricité pour les années à venir est un exercice compliqué. La “Commission d'enquête portant sur la production, la consommation et le prix de l'électricité aux horizons 2035 et 2050”, portée par le Sénat en 2024, a largement remis en question les prévisions à la hausse prédites par différents organes de modélisation et de prospective (RTE, ADEME, négaWatt, etc.). Leur conclusion[15] est néanmoins qu’une hausse de la consommation semble très probable, prenant pour leur part une hypothèse de 615 TWh en 2035 (pour 449 TWh en 2024).
RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, est aujourd’hui le mieux outillé pour modéliser le comportement du réseau électrique en fonction des interconnexions, des moyens de production et de flexibilité, la pilotabilité de la demande, etc. Le “Bilan Prévisionnel 2035” propose de très nombreux scénarios, permettant de décrire des futurs différents en fonction de choix techniques, politiques, sociétaux, mais également de mettre en avant certains paramètres impondérables des années à venir.
Evolution projetée de la consommation électrique en France entre 2022 et 2035 (TWh)
Source : Carbone 4, à partir de RTE « Bilan prévisionnel 2035 ». Interprétation de Carbone 4 permettant une mise en avant des principaux moteurs d’évolution. L’augmentation de consommation due à l’électrification des bâtiments tertiaires et résidentiels est estimée être compensée par les gains d’efficacité énergétique.
L’électrification du transport et de l’industrie devrait induire une augmentation de la demande d’électricité d’ici 2035. L’efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires et résidentiels vient compenser l’électrification des moyens de chauffage et l’augmentation de la climatisation (la récente course à la multiplication des centres de données n’est encore que partiellement modélisée). En fonction des hypothèses, la fourchette d’augmentation se situe entre 100 et 200 TWh. Ici est retenu un scénario illustratif à +120 TWh.
Pour répondre à cette potentielle hausse de la consommation d’ici 2035, seules les énergies renouvelables sont candidates
Pour répondre à cette demande supplémentaire, RTE projette une stabilisation des productions hydraulique (faible potentiel restant et anticipation de conflits d’usage) et nucléaire (fin des travaux liés aux problèmes de corrosion sous contrainte, durées et conclusions des visites décennales incertaines). Le delta repose ainsi sur une forte hausse des productions photovoltaïque et éolienne, quelle que soit la variante étudiée, y compris en cas d’hypothèses optimistes sur la flexibilité de la demande, les interconnexions ou encore la disponibilité du nucléaire.
Ainsi, la question des choix technologiques pour répondre à une demande supplémentaire de ~120 TWh en 10 ans est plutôt fermée : le déploiement du photovoltaïque et de l’éolien semble indispensable.
Les horizons 2040 et 2050 proposent des alternatives plus ouvertes (avec la mise en service de nouveau nucléaire), mais au regard de nos objectifs de décarbonation, la décennie 2030-2040 ne peut être passée à simplement attendre l’arrivée d’une potentielle série d’EPR 2.
Evolution projetée du mix de production électrique en France entre 2024 et 2035 (TWh)
Source : Carbone 4, à partir de RTE « Bilan prévisionnel 2035 » et RTE « Bilan électrique 2024 ». Interprétation de Carbone 4 permettant une mise en avant des principaux moteurs d’évolution. Les prévisions de développement de la production hydraulique notamment pour anticiper des conflits d’usage de l’eau. La production nucléaire reste stable, des variantes en cas d’échec de visites décennales de certains réacteurs étant testés par RTE.
Ce besoin de développer les filières solaire et éolienne d’ici 2035 ne doit pas masquer les autres composantes nécessaires au fonctionnement d’un réseau performant et à coûts optimisés :
- la flexibilité, en particulier de la demande (effacements, pilotage de la recharge des véhicules électriques) ;
- les moyens de production de pointe participant aux différentes réserves ou permettant du stockage (STEPs, batteries, thermique bas carbone type biogaz ou hydrogène, etc.).
Ces éléments, bien que souvent dans l’ombre, ont un rôle indispensable à jouer à court et moyen termes pour garantir l’équilibre offre / demande et limiter les coûts d’adaptation du réseau (consommer en même temps que la production, éviter le surdimensionnement, éviter les écrêtements).
Une optimisation de la production du parc nucléaire existant permettrait-elle de faire la jonction avec les premiers EPR 2 d’ici 2040, sans installer massivement du solaire et de l’éolien d’ici là ?
=> Si nous n’abandonnons pas nos objectifs de décarbonation (et donc d’électrification, +120 TWh en 10 ans), cette jonction semble impossible.
Optimiser les capacités installées ?
Des pistes d’optimisation sont possibles, mais ne permettent pas de produire ~120 TWh supplémentaires d’ici 2035.
- Augmenter le taux de disponibilité : le programme “START” de l’exploitant EDF vise à augmenter l’efficacité opérationnelle et raccourcir les arrêts de tranches pour rechargement combustible, visite décennale ou tout autre maintenance. L’année 2024 porte ses premiers fruits : près de 50 % des arrêts ont été “recouplés” avant la date cible (ie. sans consommer toutes les marges) en 2024, contre seulement 17 % en 2023[16]. Ces optimisations pourraient permettre de gagner 3 à 4 TWh/an.
- Augmenter la production en fonctionnement nominal : des travaux ont déjà permis d’augmenter de 5 % la production de certains réacteurs 900 MW, et EDF estime pouvoir encore gagner ~450 MWe[17] de puissance, soit environ 3 TWh/an.
Maintenir les capacités installées ?
- Le coût de prolongation des réacteurs du parc électronucléaire historique se situerait entre 30 et 40 €/MWh[18], ce qui en fait une solution compétitive si techniquement possible.
- L’âge moyen des réacteurs français est de 40 ans. Plus de la moitié des réacteurs devront passer leur 5e et 6e visite décennale (à 50 et 60 ans d’âge du réacteur[19]), respectivement d’ici 2035 et d’ici 2045[20]. Même si bien préparées par EDF, ces visites comportent par nature une dose d’incertitude.
- Il y a des raisons d’être optimiste : EDF et l’ASNR ont beaucoup appris et capitalisé lors des quatrièmes visites décennales du palier technologique de puissance 900 MWe. Bernard Doroszczuk, président de l’ASN à l’époque, a déclaré dans une commission d'enquête sénatoriale[21] : « la prolongation du fonctionnement de certains réacteurs au-delà de quarante ans a conduit à une importante mise à jour : le gap franchi lors de la quatrième visite décennale n'est pas représentatif de celui qui serait à franchir lors de la cinquième ou de la sixième visite [...]. Des améliorations devront encore être apportées [...], mais ces ajustements seront d'une moindre ampleur ». Les quatrièmes visites décennales des séries de 1300 MWe ne permettent pas encore d’avoir ce recul.
- Néanmoins, dans une optique de gestion des risques, la prudence reste cependant de mise : le “manque à produire” en cas de non prolongation d’un réacteur est important : une tranche de 900 MWe produit en moyenne 6 TWh par an. Anticiper un scénario dans lequel quelques réacteurs ne passeraient pas une visite décennale semble nécessaire pour assurer la résilience du réseau.
L’installation de capacités éolienne et photovoltaïque n’est pas un gouffre financier
Au début des années 2000, le déploiement des premières capacités éolienne et photovoltaïque en France s’est fait à grand renfort d’argent public car les technologies n’étaient pas encore matures, à l’échelle, les filières peu constituées, et il y avait également le coût de l’apprentissage.
En 2025, le coût complet devient compétitif, bien en deçà des moyens de production fossile, y compris en incluant les coûts liés à l’intégration au réseau. En effet, les moyens de production ne doivent pas être comparés seulement avec leur coût de production, mais également avec les services qu’ils rendent au réseau (pilotabilité, maintien de la fréquence, etc.). Les surcoûts pour le renouvelable variable (solaire et éolien) s’accentuent à mesure que leur part augmente dans le mix de production (avec des difficultés accrues au-delà de 85%[22] - ce qui laisse de la marge ; en 2024, nous étions à 13%[23]). En conclusion, en considérant l’ensemble des coûts, ceux des énergies renouvelables sont similaires à ceux du nouveau nucléaire en ordre de grandeur.
Estimations coûts complets de certains moyens de production d’électricité en France en 2025.
Inclus la construction, le fonctionnement, les renforcements réseaux (€/MWh)
Source : Carbone 4, à partir d’estimations de l’ADEME, RTE, la Cour des Comptes, l’AIE.
CCGT = Combined Cycle Gaz Turbine, centrale au gaz à efficacité et rendement élevé.
Par ailleurs, des montants mirobolants d’argent public pour le soutien aux filières renouvelables variables ont été évoqués dans certains médias (200 ou 300 Md€ - sans préciser ce que cela comprend ni sur quelle période).
Pour se donner quelques repères, voici quelques éléments.
Du côté des coûts de production, le projet de PPE N°3 estime entre 2025 et 2060 des fourchettes du montant du soutien public pour la production d’énergie renouvelable (éolien, photovoltaïque, hydraulique, biométhane, etc.) bien inférieures : entre 98 et 135 Md€ dans le scénario le plus pessimiste, de -33 à -25 Md€ dans le plus optimiste, soit entre 4 Md€/an et -1 Md€/an en fonction des scénarios de prix de l’énergie[24]. Cet investissement public est à mettre en regard du déficit commercial annuel engendré par l’importation d’énergies fossiles[25], à hauteur de 58 Md€ en 2024[26].
Certaines études tendent à conclure qu’au niveau européen l’augmentation des capacités solaires et éoliennes aurait un effet à la baisse sur les prix de gros, variabilité prise en compte (les taxes et prélèvements appliqués par les Etats peuvent ensuite compenser ou non cette baisse pour les consommateurs)[27]. Ces développements permettraient également de réduire l’impact du prix du gaz sur le prix de l’électricité[28].
Au-delà des coûts de production, l’évolution de notre système électrique engendre des coûts pour le réseau, supportés par les consommateurs via le TURPE (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité) :
- Réseau haute tension de RTE : ~100 Md€[29] d’investissement entre 2025 et 2040, à 45% pour l’intégration des renouvelables (raccordement des éoliennes en mer et des installations terrestres notamment), mais également pour adapter le réseau au changement climatique, remplacer des tronçons centenaires, intégrer les futurs réacteurs nucléaires, etc.
- Réseau moyenne et basse tension d’Enedis : ~100 Md€ d’investissement entre 2022 et 2040, dont environ 20% dédiés au raccordement des énergies renouvelables ; le reste servant à la modernisation, à l’adaptation au changement climatique et au raccordement de bornes de recharge de véhicules électriques[30].
A noter qu’il existe également d’autres coûts comme les prêts garantis par l’Etat pour le développement du nouveau nucléaire.
En conclusion, attention à bien comparer ce qui est comparable (notamment en allouant la bonne partie de surcoûts pour les renouvelables), à bien identifier qui paye quoi et à raisonner au global du système électrique (renouvelables et nucléaire inclus).
Un mix équilibré qui tire partie des avantages de chaque technologie (vitesse de déploiement, coûts, services réseau, etc.) permet de minimiser le coût et le risque global dans l’objectif de nous affranchir au plus vite des importations d’énergies fossiles.
L’électricité ne représente que 27% de notre consommation d’énergie aujourd’hui et potentiellement 50% d’ici 2050, il est urgent de parler du reste !
Se passer des combustibles fossiles, c’est électrifier, mais aussi décarboner l’usage chaleur. En effet, cette chaleur représente 45% de notre consommation finale d’énergie et repose à 75% sur des énergies fossiles (gaz en majorité). La nature des usages est variée (chauffage particulier, réseau de chaleur pour les collectivités, processus industriel à haute température), tout comme les solutions pour se décarboner.
Le potentiel de production d’énergie thermique bas carbone à long terme est supérieur à ~500 TWh, équivalent en ordre de grandeur à notre consommation actuelle de chaleur. Le débat public gagnerait à apporter autant d’attention à ces filières qu’aux discussions souvent stériles autour du nucléaire et des renouvelables électriques.
Mise en regard de la consommation de chaleur actuelle, du potentiel de nouveau
thermique renouvelable à long termes (> 2050) vs la cible photovoltaïque et éolienne à 2035 (TWh)
Source : Carbone 4, à partir d’estimations du BRGM, et de l’ADEME notamment.
BT = Basse Température, HT = Haute Température.
Conclusion
La Programmation Pluriannuelle de l'Énergie fixe un cap pour le mix énergétique français jusqu’à 2035 et acte un chemin jusqu’à horizon 2050.
Ce cap, c’est la sortie des énergies fossiles pour répondre aux enjeux climatiques, améliorer notre balance commerciale et retrouver notre indépendance sur la scène géopolitique.
Ce cap permet de planifier les investissements publics comme privés, d’orienter les filières professionnelles, de s’assurer que les volumes nécessaires aux usages de demain seront bien disponibles à un prix compétitif et acceptable par les entreprises et les ménages.
En ce qui concerne l’électricité (il faut aussi penser chaleur renouvelable), développer du nouveau nucléaire à horizon 2050, en particulier pour compenser les fermetures des réacteurs historiques, doit conduire à orienter des travaux ad hoc dès aujourd’hui. À plus court terme, accélérer la sortie des énergies fossiles devrait conduire à une augmentation de notre consommation d’électricité de plus de 100 TWh d’ici 2035. Pour répondre à cet impératif, seules les énergies renouvelables électriques, en particulier photovoltaïque et éolienne, sont des candidates crédibles : elles sont compétitives, s’installent vite et génèrent des emplois en France. Leur caractère variable impose d’adapter le fonctionnement de notre réseau mais le bénéfice à en retirer est largement positif.
Un tel exercice de planification, avec des impacts concrets sur l'ensemble de nos modes de vie, ne peut être traité qu’avec sérieux et nuance. Nous assistons en ce moment davantage à des raisonnements simplistes, plus proches du slogan ou du symbole politique que du réel exercice de planification basé sur des faits, méthodique et mesuré.
Contactez-nous
Pour toute question sur Carbone 4, ou pour une demande concernant un accompagnement particulier, contactez-nous.