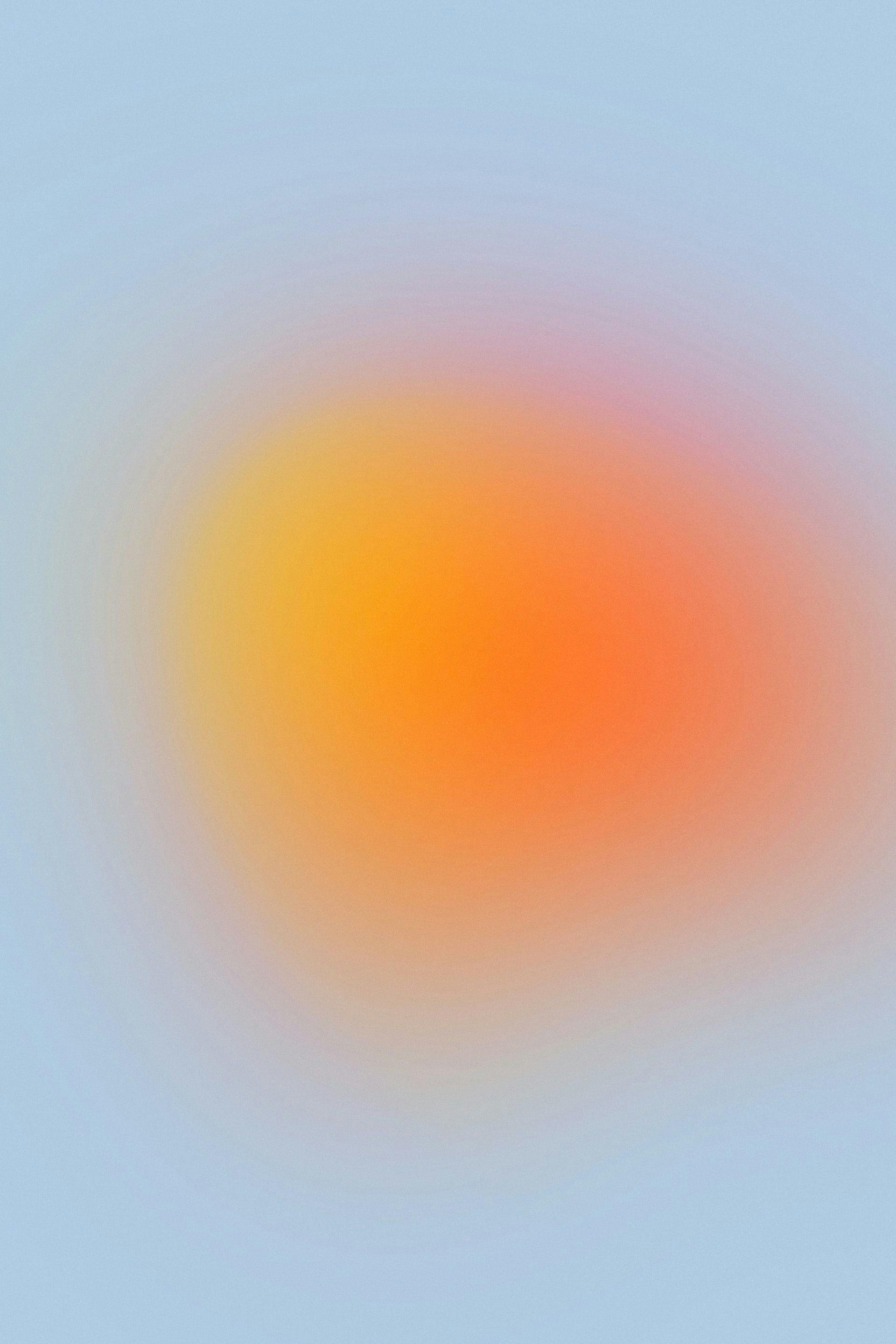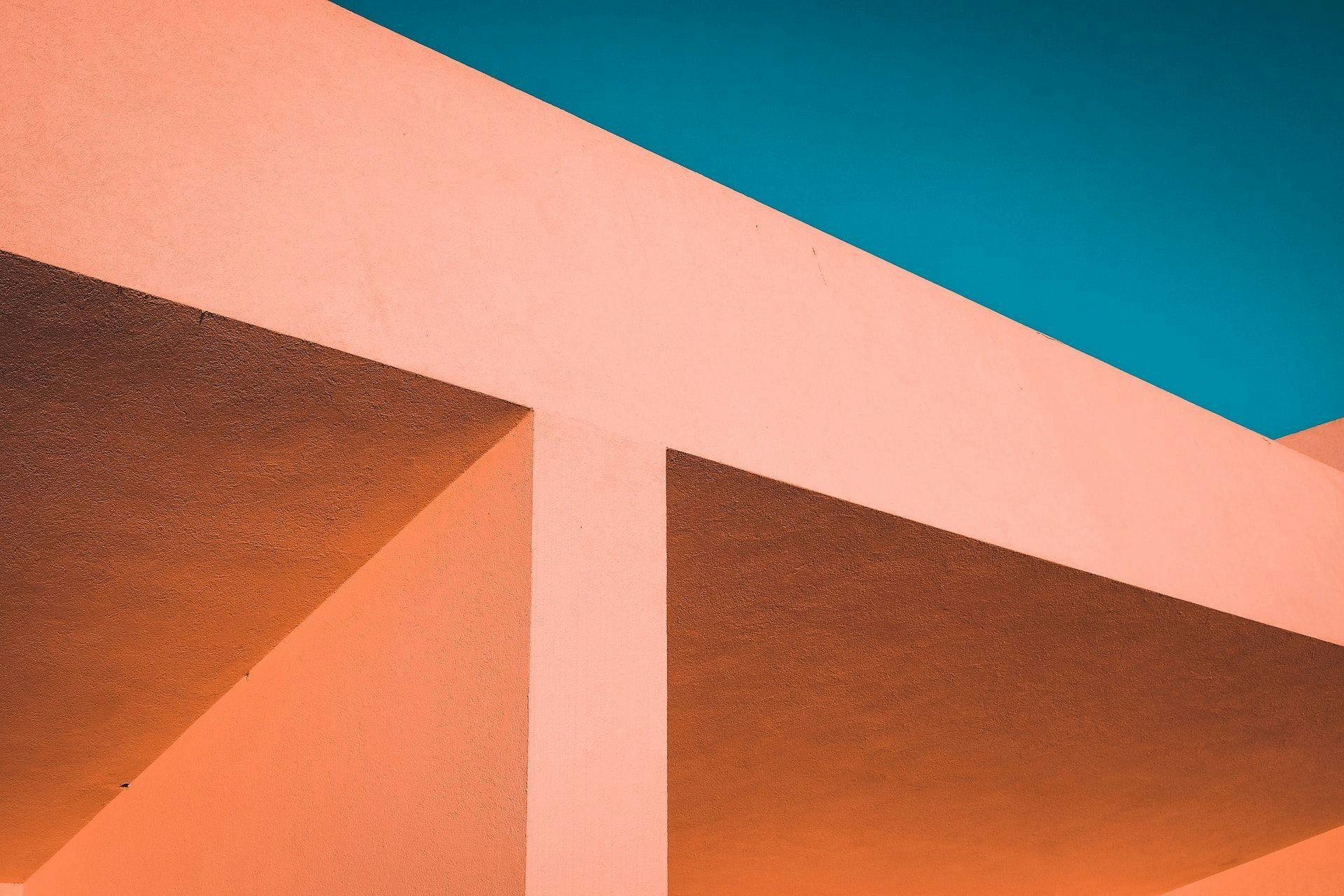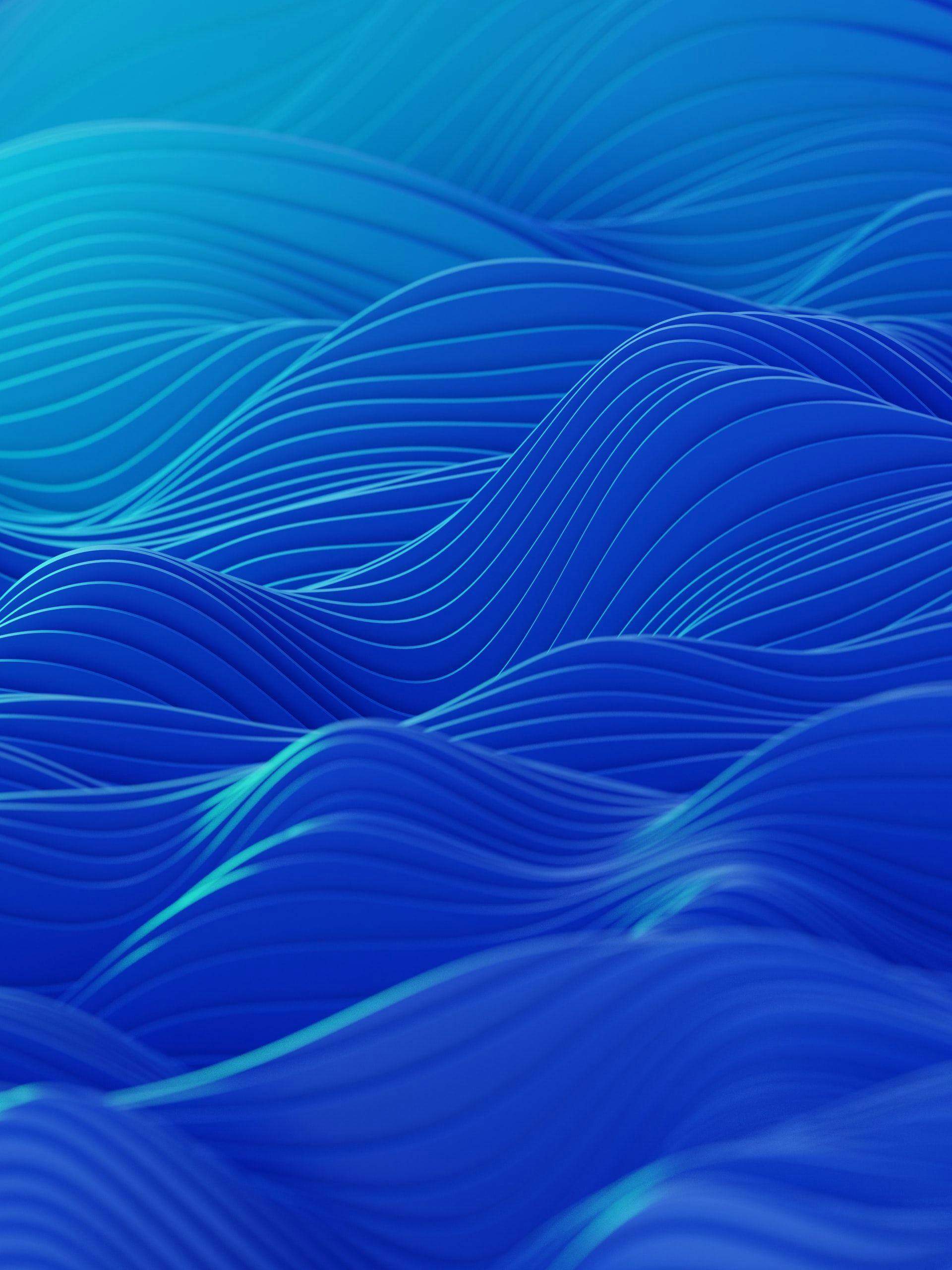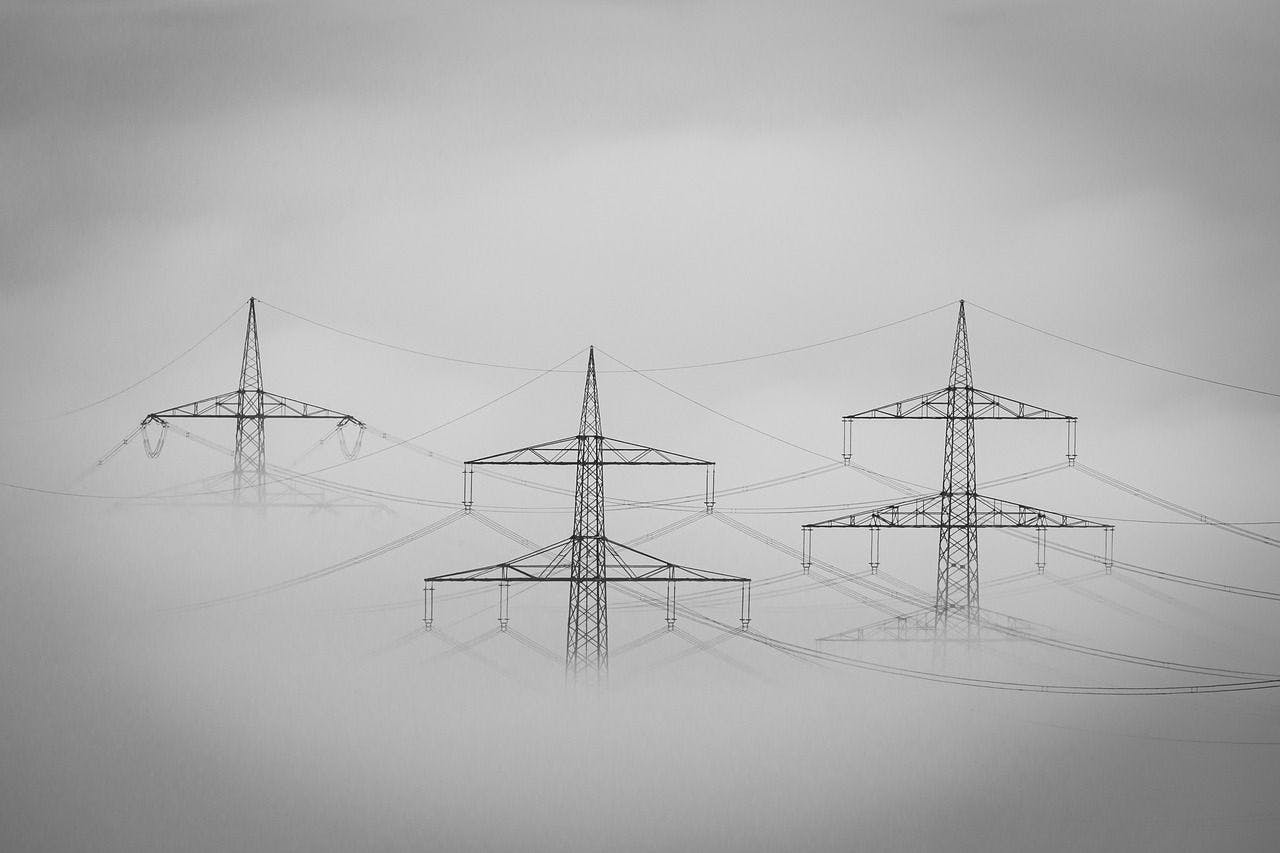Electrifying low-temperature heat in the Food and Beverage industry in France
Electrification of low-temperature heat production in industry: a key decarbonization lever whose adoption is lagging behind
Publication en anglais
Une étude commissionnée par the European Climate Foundation
Contact: Gian Luca Agliardi
Contributeurs Carbone 4 à l'étude : Alexandre Huon de Kermadec, Célia Cornec
Participation aux ateliers et interview : DGEC, ADEME, Newheat, Industrials
Introduction
La transition vers une économie bas carbone prend du retard et nécessite une action conjointe et systémique de l'ensemble du monde économique : gouvernements, entreprises et consommateurs finaux. Tous les aspects de nos sociétés doivent être repensés à la lumière des limites planétaires. L'Accord de Paris signé lors de la COP21 en 2015 vise à limiter le réchauffement climatique à +2 °C par rapport à l'ère préindustrielle. Les pays signataires sont tenus de traduire cette ambition en objectifs climatiques ambitieux pour leur pays, via des contributions déterminées au niveau national (CDN). En France, les objectifs climatiques sont fixés dans la Stratégie nationale bas carbone (SNBC).
La SNBC définit des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) par secteur, afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. L'industrie, troisième secteur le plus émetteur en France après les transports et l'agriculture, a un rôle important à jouer dans la décarbonation du pays. En effet, la SNBC prévoit une réduction de 5 fois les émissions industrielles de GES d'ici 2050, par rapport à 2015 (réduction de 4 fois par rapport au niveau des émissions de GES de 2023). Cela correspond à une réduction annuelle des émissions industrielles de -4,5 %[1]. L'industrie est déjà en retard, avec une baisse des émissions de seulement 2,7 % par an entre 2015 et 2023[2].
L'industrie est souvent considérée comme un secteur "hard to abate" (i.e. difficile à décarboner), en raison des industries lourdes, telles que les industries chimiques et métallurgiques, qui nécessitent de la chaleur à très haute température. Cependant, elle comprend également de nombreuses activités et processus nécessitant de la chaleur basse température (<100 °C). Si les technologies bas carbone pour la production de chaleur à haute température sont encore en cours de développement, les besoins en chaleur basse température pourraient être satisfaits par des solutions bas carbone éprouvées, et en particulier par l'électrification. La trajectoire de décarbonation de la SNBC pour l'industrie souligne l'importance de l'électrification, car elle part du principe que celle-ci passera d'environ 25 % aujourd'hui à 70 % de la consommation énergétique de l'industrie en 2050.
L'électrification de la chaleur industrielle à basse température dépendra en grande partie des technologies d'électrification directe, telles que les pompes à chaleur industrielles et les chaudières électriques. Les pompes à chaleur, en particulier, peuvent être couplées à des systèmes de récupération de chaleur, à des centrales solaires thermiques ou à des systèmes géothermiques. Cette intégration améliore efficacement la source de chaleur pour la pompe à chaleur, réduisant ainsi la différence de température à atteindre et améliorant les performances globales de l'équipement. Les pompes à chaleur industrielles et les chaudières électriques actuellement disponibles sur le marché sont des technologies matures capables d'atteindre des températures supérieures à 150 °C[3]. Il ne semble donc pas y avoir d'obstacles technologiques majeurs à la transition des secteurs ayant des besoins en chaleur basse température. Cependant, ces industries restent fortement dépendantes des énergies fossiles et peinent à se décarboner au rythme nécessaire. Ce paradoxe soulève la question de savoir pourquoi leur transformation progresse si lentement.
L'industrie agroalimentaire a été identifiée comme un secteur pertinent pour tenter de comprendre ce paradoxe. En France, elle représente 11 % des émissions de l'industrie et 2 % des émissions totales de GES[4]. Plus de la moitié de la consommation d'énergie du secteur agroalimentaire est utilisée pour la production de chaleur[5] et de nombreux processus de cette industrie, parmi lesquels le séchage, la pasteurisation ou la distillation, nécessitent de la chaleur basse température. Environ 75 % de la chaleur nécessaire aux processus est inférieure à 150 °C, et environ 50 % inférieure à 100 °C[6]. Plusieurs études ont montré que l'industrie agroalimentaire est un candidat privilégié pour réduire sa production de chaleur à partir de combustibles fossiles au profit d'une production de chaleur bas carbone, notamment par l'électrification. Tout d'abord, l'ADEME s'est penchée sur le potentiel de remplacement de la consommation de combustibles fossiles pour les processus thermiques dans l'industrie par des techniques électriques[7]. Un tiers du potentiel total de l'industrie se trouve dans l'industrie agroalimentaire, ce qui en fait le secteur industriel présentant le plus fort potentiel d'électrification des procédés thermiques. Ensuite, l'Agence internationale de l'énergie (AIE), dans son rapport «The future oh heat pumps»[8], affirme que 40 % des besoins en chaleur de l'industrie agroalimentaire pourraient être couverts par des pompes à chaleur.
Cependant, le secteur agroalimentaire reste fortement dépendant des combustibles fossiles, principale source d'émissions directes, et plus particulièrement du gaz naturel, qui représentait 50 % de sa consommation d'énergie en 2022. Cette part est relativement stable depuis 2010, où elle s'élevait également à 50 %. Par ailleurs, la part de l'électricité dans la consommation totale d'énergie a légèrement augmenté, passant de 32 % en 2010 à 39 % en 2022[9], ce qui reste légèrement supérieur au reste de l'UE où l'électrification dans l'industrie stagne en moyenne autour de 33 %[10]. Il reste donc un long chemin à parcourir pour atteindre 70 % de la consommation d'énergie d'ici 2050.
L'objectif de l'étude suivante est donc de fournir un aperçu des obstacles à l'électrification rencontrés par l'industrie agroalimentaire et de formuler des recommandations à l'intention des décideurs publics et de l'industrie elle-même.
This study has been supported by the European Climate Foundation. Responsibility for the information and views set out in this study lie with the author[s]. The European Climate Foundation cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained or expressed therein.