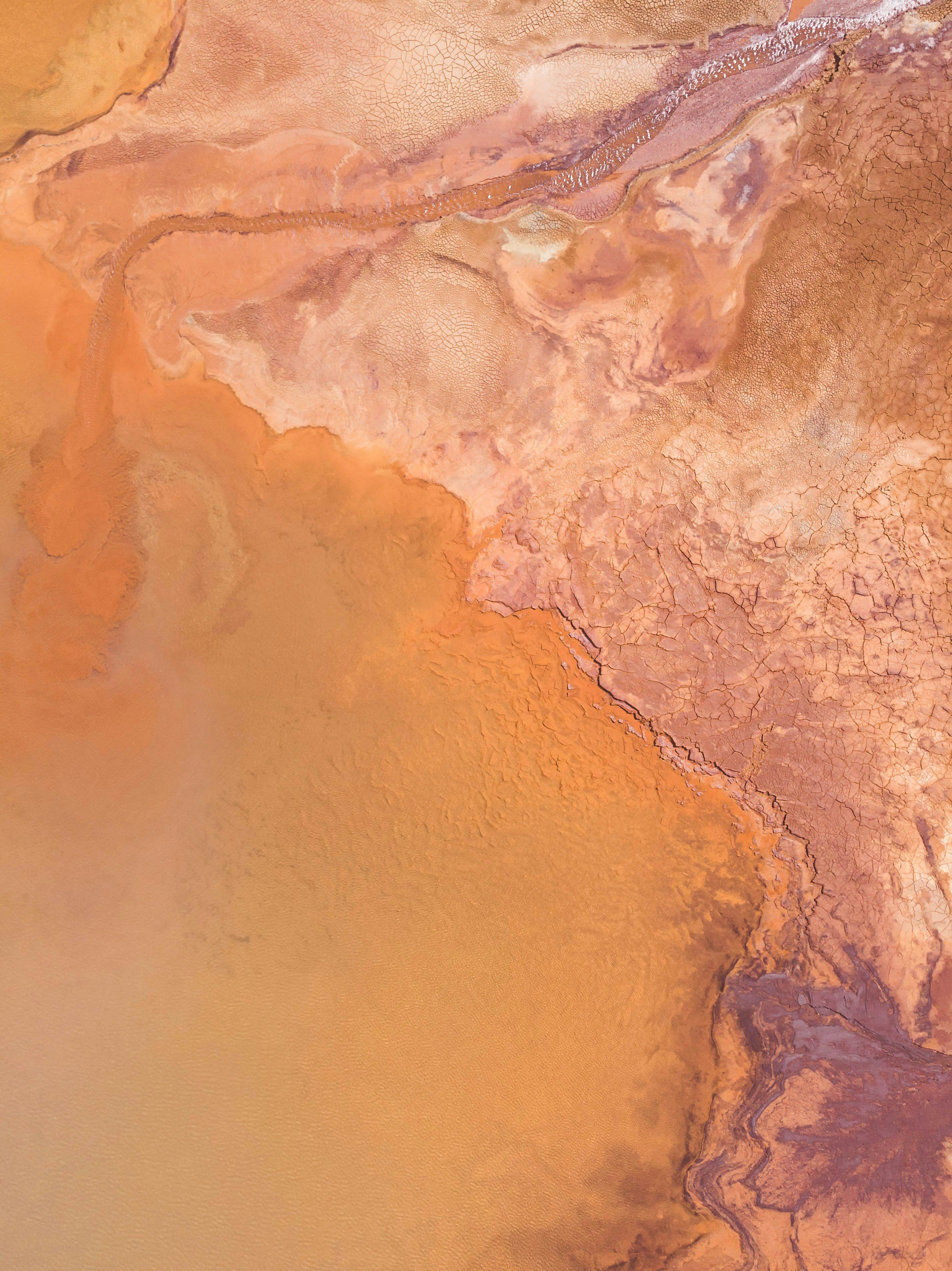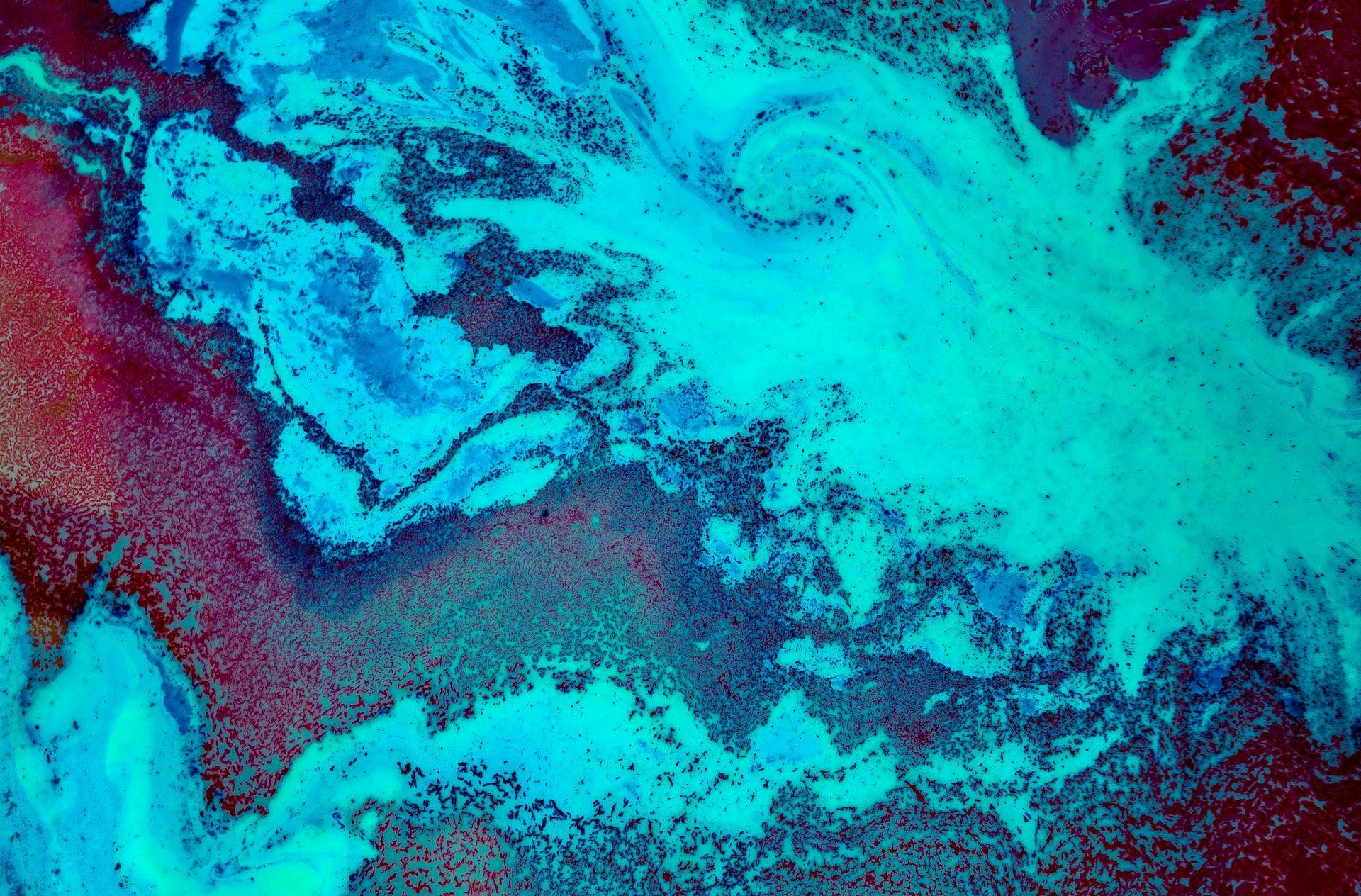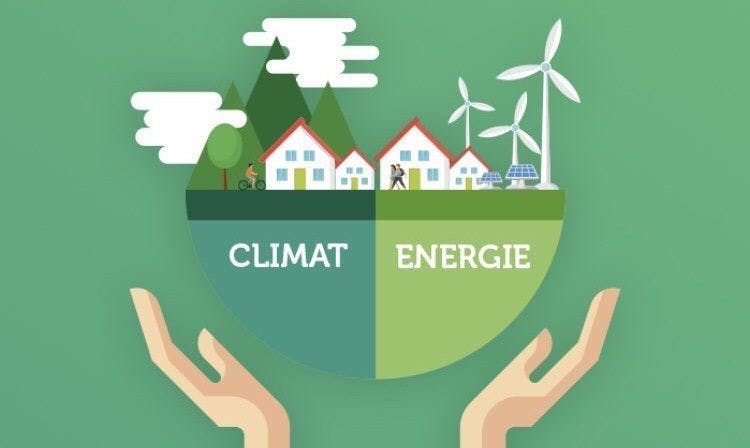Interview de Christophe Terrien, responsable enjeux climat chez ArianeGroup
"Introduire le sujet climat à travers le risque, c’est parler à l’entreprise un langage qu’elle connaît."
Après près de 30 ans dans le secteur spatial, Christophe Terrien prend en charge les enjeux climatiques en 2020. Dans un entretien, il nous partage son retour d’expérience sur la montée en puissance des sujets climats au sein d’ArianeGroup, en particulier sur la prise en compte des enjeux d’adaptation.
Comment légitimer et structurer la démarche climat ? Comment appréhender la complexité opérationnelle de l’adaptation ? Comment faire face aux freins financiers et temporels rencontrés ?
Vous êtes actuellement en charge des sujets d’adaptation chez ArianeGroup. Comment la question de l’adaptation a-t-elle émergé dans l’entreprise ?
A titre personnel, j’ai adressé le sujet des enjeux climatiques il y a environ 5 ans. Je suis tombé sur les conférences du cours des Mines de Jean-Marc Jancovici, et je me suis engagé à titre personnel. Mais j’ai rapidement compris le défi par rapport au monde de l’entreprise : comment faire avancer la thématique dans le monde professionnel en général et dans mon secteur en particulier ?
En 2021, j’ai pu participer avec le soutien de ma hiérarchie à la formation « Climat et entreprise »[1] proposée par la Carbone 4 Académie. Ça a été un vrai déclic. Mon approche du sujet se limitait jusqu’alors aux enjeux de décarbonation. Cette formation intégrée sur le changement climatique dans le monde de l’entreprise m’a permis d’ouvrir les yeux sur les enjeux d’exposition aux aléas climatiques et de risques physiques exercés sur nos chaînes de valeur économiques. Venant du monde du risque industriel, j’ai tout de suite vu l’adaptation comme une manière pertinente d’introduire le sujet « Climat » dans les entreprises : le management du risque fait partie intégrante du mindset d’une entreprise par définition, quelle que soit la forme que prenne ce risque (industriel, financier, coûts, logistique, fournisseur). Et donc introduire le sujet climat à travers la notion de « risque », c’est parler à l’entreprise un langage qu’elle connaît.
Le sujet “atténuation” / « décarbonation », reste souvent compris comme un enjeu de communication RSE, et dès lors il est souvent traité (malheureusement) comme un sujet secondaire, qui ne fait pas partie des priorités d’ordre 1 des entreprises, à part quelques exceptions. Rentrer par le prisme du risque climatique qu’il soit de transition ou adaptation, ça permet de sortir la thématique du pur enjeu moral ou sociétal vers une variable complémentaire à manager pour l’entreprise.
Sur la base de cette formation et d’une réflexion interne avec ma hiérarchie, j’ai ainsi basculé d’un poste d’Expert en risques industriels vers celui de Chargé de performance environnementale, avec pour objectif de développer la stratégie globale sur les enjeux associés au changement climatique — tant en atténuation qu’en adaptation et acculturation des entités de la société.
Concrètement, comment avez-vous fait pour faire accepter ce choix assez déterminant en interne ?
Notre stratégie a été dès le départ de rendre visible le paramètre « Changement climatique » en mettant en lumière le sujet au travers de situations, d’événements, même anodins, que subissait ou auxquels était confrontée l’entreprise : demandes d’associations ou de jeunes actifs sur nos actions envers le changement climatique, demandes clients, organismes financiers, exigences réglementaires à venir, perte/retard de production associé à un aléa climatique, coûts (et approvisionnement) de l’énergie…
La pertinence de cette démarche nous a donné raison avec en 2022, un épisode de grêle extrêmement destructeur sur l’un de nos sites et qui a induit de fortes perturbations sur la chaine de valeur d’un de nos produits principaux. Certes à l’époque, on n’attribuait pas directement le changement climatique comme cause d’un épisode de grêle, mais ce type d’événement a permis de révéler une vulnérabilité particulière de certaines de nos installations à des aléas climatiques.
Depuis, nous avons structuré la démarche avec un registre des événements climatiques qui permet de répertorier l’ensemble des conséquences et signaux faibles observés sur nos sites. A chaque événement climatique (tempête, pic ou vague de chaleur, sécheresse, pluies intenses…) — chaque site ouvre sa ligne dans le registre et identifie les conséquences observées : arrêt d’alimentation électrique, dégâts, arrêts de production… ou rien du tout d’ailleurs ! L’objectif est de rendre le sujet concret pour les équipes. Ces enregistrements nous permettent à l’échelle d’une année d’évaluer les impacts (et leur évolution) sur l’activité.
Tout cela a permis de montrer qu’il fallait traiter le changement climatique comme un sujet à part entière, à intégrer dans l’ensemble des process de l’entreprise. Que le mot “climat” n’était pas un “gros mot”, associé à des vertus écologiques, mais un paramètre du management en entreprise, de la même manière que les coûts ou les délais, et ce quelle que soit l’entité de l’entreprise : RH, achat, production, logistique, juridique, communication…. Et enfin que cette thématique est une hydre à 2 têtes : adaptation et atténuation.
Au-delà de votre compréhension des enjeux associés à l’adaptation aux aléas climatiques, quels éléments ont contribué à intégrer le sujet au sein de l’entreprise ?
L’écoute des parties prenantes de l’écosystème est également importante et permet de mettre en perspective des besoins d’évolution de nos organisations.
Quand un client intègre de nouvelles exigences en lien avec le changement climatique dans un cahier des charges, cela devient un sujet. Certains clients, étatiques notamment, ont ainsi commencé par exemple à intégrer le sujet « adaptation » dans leurs exigences, et cela nous aide.
L’évolution du cadre réglementaire est également une source d’accompagnement du changement. La mise en place des évaluations de double matérialité de la directive de durabilité européenne et la parution du standard « Climat » associé impliquent d’intégrer la gestion de l’adaptation. En France, la séquence de communication et de préparation du PNACC « La France à 4°C » a également permis de mettre en lumière ces enjeux.
Tous ces exemples sont des opportunités de communication mais également de réflexion, afin de les anticiper pour ne pas les subir.
L’émergence du sujet est donc passée par une démarche construite de sensibilisation, que vous identifiez d’ailleurs comme une composante à part entière de votre poste.
La sensibilisation est fondamentale, notamment vers le comité exécutif dans un premier temps. Le plus important, c’est d’avoir mandat du plus haut niveau de management. Aujourd’hui, on l’a : il y a une écoute et une attente de résultats, notre politique Climat est validée par notre CEO avec des moyens et des objectifs clairs, ce qui permet de les décliner au sein des entités de la société. Mais embarquer les salariés des sites est également important : cela génère des propositions, évite la posture d’injonction.
Les ressorts de communication sont différents : A titre individuel, c’est un sujet de société, et les gens ont besoin de sens dans leur travail et ils sont plutôt demandeurs dès qu’on communique sur le sujet. On fait des webinaires de présentation du bilan carbone et on remplit la salle virtuelle sans souci. On est plutôt bien reçus voire challengés. Mais dans les arbitrages stratégiques de l’entreprise, la question climatique peut parfois être prise comme une exigence supplémentaire dans un champ de contraintes déjà bien garni.
Mais souvent, au bout d’un moment arrive la question du coût : où trouver l’argent pour financer des changements parfois structurels ? Avec parfois comme solution de parler de coût de l’inaction ?
Sur la question du financement, on applique la technique des petits pas. D’abord identifier les enjeux avant de répondre en solutions, et construire celles-ci sur la durée, pas comme un tout immédiat. Laisser maturer le sujet dans le système.
Je rappelle que parler climat, c’est parler « risques », ainsi l’investissement qu’on accepte de mettre dans l’adaptation est à évaluer au regard des coûts à venir si on ne s’en préoccupe pas, et celui-ci est souvent moindre que la non ou mal-adaptation. Malheureusement ce coût de l’inaction reste encore difficile à évaluer et intégrer dans la démarche, peu d’outils sont disponibles et sans doute n’avons-nous pas non plus trouvé les bons slogans pour le vendre. A bon entendeur !
Il est plus intéressant je pense d’expliquer qu’il n’est pas nécessaire de tout traiter à l’instant t, voire parfois qu’il est urgent d’attendre. Que l’essentiel c’est d’avoir une feuille de route. J’ai eu la remarque récemment : “ça va coûter cher”. Tu n’es pas obligé de tout faire, mais on parle de risques pour l’entreprise, donc d’une variable de management de l’entreprise. Dans tous les cas, faire son évaluation, son étude de vulnérabilité, ça permet de comprendre ses enjeux, mettre des éléments factuels et chiffrés derrière cette notion de risque physique. C’est la première pierre fondamentale : poser le problème à travers une photographie de sa vulnérabilité.
De plus, la connaissance des enjeux et la construction de cette feuille de route peut permettre de bénéficier potentiellement d’opportunités : mon site vieillit et dans 5 ans je vais devoir changer la toiture, l’isolation… donc c’est OK d’attendre. Ce n’est pas “je m’adapte à 100 % aujourd’hui”, c’est : je construis mon calendrier en tenant compte de ce qu’il faut prioriser, reporter et ce qu’il faut suivre dans le temps.
Que recommanderiez-vous pour avancer de manière efficace sur les sujets d’adaptation ? Quels sont les pièges à éviter ?
Première règle, commencer par le commencement : « s’informer ». Il existe maintenant une littérature abondante sur le sujet avec des niveaux plus ou moins importants de vulgarisation qui permettent de trouver l’approche qui vous convient.
Ensuite, faire son évaluation de vulnérabilité aux aléas climatiques, sans réflexion d’adaptation ni solution, un simple constat à l’état 0 des enjeux pour l’entreprise afin de nourrir la réflexion.
Au niveau des écueils, le premier dans lequel il ne faut pas tomber, c’est le rapport à la méthodologie d’analyse de la vulnérabilité : OCARA nous a apporté la structuration nécessaire à la démarche, pour construire un reporting pertinent, plutôt que de rester sur des ressentis ou des perceptions. Mais il ne faut pas pour autant faire de l’outil la réponse au sujet. Un outil reste un outil, il est là pour nous accompagner, structurer un résultat, mais il faut se l’approprier.
Ainsi, au niveau d’ArianeGroup, je me suis tout d’abord formé sur OCARA pour évaluer la pertinence de l’usage sur nos activités et nos attentes en termes d’évaluation puis nous avons fait un test grandeur nature sur un petit périmètre avec quelques volontaires. Sur cette base nous avons pu traduire la méthodologie dans un format et un vocabulaire, des métriques… adaptées à notre chaine de valeur. Ensuite, nous avons formé, avec l’aide de Carbone 4, une dizaine de personnes pour pouvoir déployer la thématique sur l’ensemble des sites. Enfin, avant toute session OCARA, avec le pilote du site, nous préparons une version adaptée du cadre OCARA (transcription physique des processus) à ses spécificités. Ainsi, quand on débute la session avec les participants, on leur parle de quelque chose de concret, qu’ils peuvent visualiser, chaque processus se rattache à quelque chose qu’ils connaissent. Et c’est comme ça qu’on arrive à faire des choses intéressantes.
Autre écueil, la difficulté de se projeter dans le monde de demain, à horizon, 5, 10, 20, 30 ans. Le secteur de la donnée climatique est en plein essor, mais une donnée reste une donnée et peut ne pas être représentative de l’attendu ou difficilement exploitable, avec de plus parfois des biais et des incertitudes élevées pour certains aléas. Comment prendre des décisions sur la base d’informations qui n’intègrent pas totalement la réalité physique sous-jacente ou pour lesquelles parfois le niveau d’incertitudes est élevé. Je préfère parler aujourd’hui du besoin de construction de « narratifs climatiques » adaptés à nos enjeux et besoin de perception (certes basés en partie sur des données, mais pas que et surtout sélectionnées, exprimées de manière pertinente par rapport à notre besoin).
Au regard des incertitudes élevées sur l’aléa grêle et de la vulnérabilité de certains actifs à cet aléa, nous avons décidé par exemple que cet aléa était un aléa pertinent à traiter au titre de l’adaptation pour les sites concernés, indépendamment de toute évaluation probabiliste et data spécifique sur l’exposition.
Autre exemple, s’assurer que la donnée représente bien le niveau d’enjeu attendu : Quelle température critique est à prendre en compte pour mon personnel ou mes bâtiments ? Pas forcément la même ? Quelles sont celles qui sont pertinentes pour mon référentiel de risque ?
Que vous a apporté le pôle adaptation de Carbone 4 dans votre démarche d’adaptation ?
Tout d’abord un cadre méthodologique avec OCARA.
Ensuite, une écoute : lors de la phase initiale de test d’OCARA, nous avons pu remonter nos observations sur la pertinence de l’outil et de sa structure, observations qui ont été prises en compte.
J’apprécie également l’approche qui reste exigeante mais ancrée dans la réalité du système économique. Vous ne faites pas des réponses théoriques, vous avez une vision réelle de l’entreprise et vous savez répondre à un besoin pragmatique tout en respectant les fondements méthodologiques.
Enfin, le club adaptation de Carbone 4 nous apporte un cadre de réflexion et d’échanges avec d’autres industriels permettant de croiser des démarches et partager nos réussites et difficultés. C’est un vrai plus !
Un mot pour conclure ?
Un objectif principal doit nous guider : faire entrer le mot « Climat » dans le champ lexical de l’entreprise. Celui-ci ne doit pas / plus être perçu comme une lubie d’écolo ou une simple variable périphérique de communication mais comme un paramètre de management de l’entreprise à part entière et intégrer la culture de l’entreprise et ses processus.
Contactez-nous
Pour toute question sur Carbone 4, ou pour une demande concernant un accompagnement particulier, contactez-nous.